La
méthanisation
Des biogaz au biométhane
La méthanisation est un processus naturel de
dégradation biologique de la matière organique dans
un milieu sans oxygène due à l’action de multiples
micro-organismes (bactéries).La
biométhanisation est aujourd’hui une des principales
techniques pour valoriser une part importante des
déchets fermentescibles.
Si la phase de production de biogaz brut est relativement
simple, une ou plusieurs étapes de traitement (nettoyage,
raffinage) sont nécessaires pour permettre l’utilisation
du biogaz produit, que ce soit sous forme de simple
biogaz, du bio-méthane ou de bio-hydrogène.
|
|

Installation
de méthanisation à Telaviv
Parmi
les constituants indésirables présents dans le biogaz
à traiter, on peut citer les siloxanes et l’hydrogène
sulfuré (H2S) comme faisant parti des plus problématiques.
|
 Pourquoi méthaniser nos déchets ?
Pourquoi méthaniser nos déchets ?
La
méthanisation, encore sous-utilisée aujourd'hui, apparaît
comme une réponse à la double problématique de la gestion
des déchets et du développement des énergies renouvelables.
 Quel est le bilan CO2 d'une unité
de méthanisation ?
Quel est le bilan CO2 d'une unité
de méthanisation ?
Chaque
m3 de biogaz produit évite le rejet dans l’atmosphère
de 2,3 kg de CO2 responsable du réchauffement climatique.
Un projet de méthanisation de 2 MW électrique permet d’éviter
l’émission d’environ 9 000 t de CO2
dans l’atmosphère.
En général, cela génère une économie de CO2 car les matières sont traitées sur place.
Sur l’ensemble, le transport additionné ne dépasse pas 10
% du bilan carbone.
Cependant,
il faut avoir présent à l’esprit que chaque m3
de
biogaz produit contient 6 Kg de CO2 qui est rejeté
à l’atmosphère, soit lors de la purification en biométhane,
soit dans l'utilisation du biogaz sans purification.
 La méthanisation ?
La méthanisation ?
Elle
peut avoir lieu naturellement dans certains milieux tels
que les marais ou peut être mise en œuvre volontairement
dans des unités dédiées grâce à un équipement industriel.
Toute les matières organiques sont susceptibles d’être ainsi
décomposées (excepté des composés très stables comme la
lignine) et de produire du biogaz, avec un potentiel méthanogène
toutefois très variable.
La méthanisation convient particulièrement aux substrats
riches en eau, contenant de la matière organique facilement
dégradable, et facilement pompables pour permettre un fonctionnement
en continu.
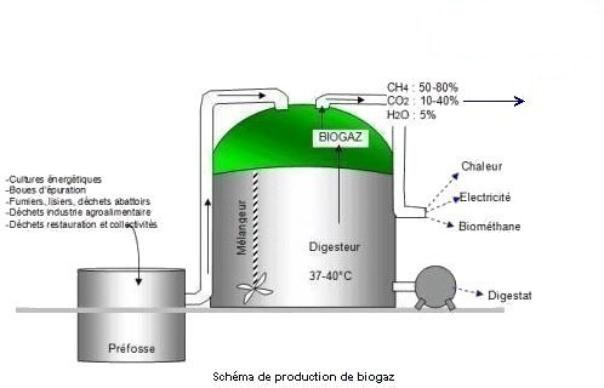
Les déchets méthanisés peuvent être d’origine :
- Agricole
: déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes
de maïs …), eaux de salle de traite, etc...
- Agro-industrielle
: abattoirs, caves vinicoles, laiteries, fromageries,
ou autres industries agro-alimentaires, chimiques et pharmaceutiques,
etc...
- Municipale
: tontes de gazon, fraction fermentescible des ordures
ménagères, triée à la source (biodéchets) ou non (TMB),
boues et graisses de station d’épuration, matières de
vidange, etc...
La
co-digestion d’un mélange de déchets organiques est à préconiser
pour permettre des économies d’échelle et optimiser la production
de biogaz.
La
méthanisation aboutit à la production :
-
d’un produit humide riche en matière organique partiellement
stabilisée appelé digestat.
Il est généralement envisagé le retour au sol du digestat
après éventuellement une phase de maturation par compostage;
-
de biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du
digesteur et composé d’environ 50 % à 70 % de méthane
(CH4), de 20 % à 50 % de gaz carbonique (CO2)
et de quelques gaz traces (NH3, N2,
H2S).
En moyenne, 100 m3 de biogaz
contiennent 70 m3 de méthane pur (biométhane)
utilisables comme source d’énergie et environ 60 Kg de CO2.
Ainsi ces 70 m3 de biométhane (soit 600.000
kcal) sont l’équivalent de 70 litres de fioul.
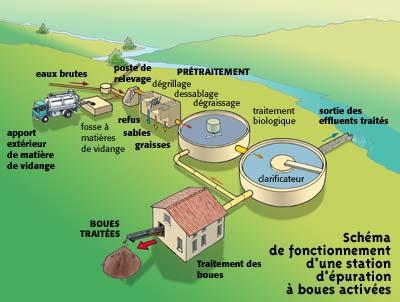
Figure:
70 m3 de biométhane
sont l’équivalent de 70 litres de fioul
En moyenne, 10 tonnes de biogaz
produit par méthanisation fournit 7 tonnes de méthane
et 3 tonnes de CO2.
Le
biogaz a un Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de 5 à 7
kWh/Nm3 . Cette énergie renouvelable peut être utilisée
sous différentes formes :
- combustion
pour la production d’électricité et de chaleur,
- production
d’un carburant,
- injection
dans le réseau de gaz naturel après épuration.
En
l'état actuel des procédés biologiques
de méthanisation permettant de valoriser des matières
organiques en produisant des biogaz, les intérets
environnementaux mis en avant sont avant tout:
Diminution
des GES (gaz à effet de serre) comme CH4 (méthane)
et CO2 (gaz carbonique)
Parmi
ces GES, le dioxyde de carbone représente environ
70% des gaz à effet de serre d'origine anthropique.
Il est principalement issu de la combustion des énergies
fossiles (pétrole, charbon) et de la biomasse dont
la méthanisation.
Cette
réaction de méthanisation produit également un résidu, appelé
digestat, qu’il est ensuite possible de valoriser en tant
que fertilisant pour l’agriculture.
Le biogaz produit par la méthanisation peut être valorisé
de différentes manières :
- par
la production d’électricité et de chaleur combinée dans
une centrale en cogénération ;
- par la production de chaleur qui sera consommée à proximité du
site de production ;
- par l’injection dans les réseaux de gaz naturel après une étape
d’épuration (le biogaz devient alors du biométhane) ;
- par la transformation en carburant sous forme de gaz
naturel véhicule (GNV)
Le
biogaz est le résultat de la méthanisation ou
digestion anaérobie de
déchets fermentescibles. Les sources les plus courantes
de biogaz (contenant le biométhane) proviennent des stockages
de matière organique volontaires ou involontaires :
- Les
cultures.
- Les
décharges : leur teneur en biogaz est plus ou moins
élevée en fonction de l'étanchéité du mode d'exploitation.
- La
collecte sélective des déchets putrescibles permet une
méthanisation plus rapide qu'en décharge en utilisant
des bioréacteurs spécifiques (digesteurs).
- Les
boues des stations d'épuration : la méthanisation
permet d'éliminer les composés organiques et permet à
la station d'être plus ou moins autonome
en énergie.
- Les
effluents d'élevages : la réglementation rend obligatoire
les équipements de stockage des effluents (lisier, fumier)
pour une capacité supérieure à 6 mois.
Ce
temps de stockage peut être mis à profit pour la méthanisation
des effluents. Il s'agit des déjections animales mais
aussi des autres déchets agricoles:
résidus de culture et d'ensilage, effluents de laiteries,
retraits des marchés, gazons etc. ;
- Les
effluents des industries agroalimentaires peuvent aussi
être méthanisés. Le but est principalement d'éviter le
rejet de matières organiques trop riches,
et peut s'accompagner d'une valorisation énergétique ;
Le
biométhane est une source d'énergie alternative, renouvelable
et propre. Il contribuera à porter à 23% la part des énergies
renouvelables dans la consommation totale d'énergie, objectif
gouvernemental que s'est fixé la France pour 2020.
Le
biométhane est une énergie renouvelable car directement
issue des déchets présents sur un territoire. Produit à
partir de la fermentation de déchets agricoles, ménagers,
industriels ou encore des boues de station d'épuration,
le biométhane est un biogaz épuré jusqu'à la qualité du
gaz naturel.
Une fois odorisé, contrôlé, compté, et sa pression régulée,
il est injecté dans le réseau de distribution. C'est une
énergie propre, ses usages sont strictement identiques à
ceux du gaz naturel, mais 100% renouvelables.
Le biométhane, une énergie renouvelable aux multiples
avantages :
-
Valoriser les déchets pour produire une
énergie renouvelable : la production de biométhane s'inscrit dans un cycle vertueux
dans lequel les déchets deviennent des ressources pour produire
une énergie locale et renouvelable qui se substitue aux
énergies conventionnelles ;
-
Réduire les émissions de gaz à effet de
serre : les déchets organiques produisent naturellement du méthane en se dégradant.
La collecte et le traitement des déchets évitent ces émissions
dans la nature et les transforment en énergie propre. Le
bilan d'émissions de gaz à effet de serre à l'utilisation
de cette énergie est donc quasiment neutre car le CO2
produit par la valorisation du biométhane a préalablement
été capté par les matières organiques dégradées
 La
filière biogaz-biométhane
La
filière biogaz-biométhane
Les
utilisations du biométhane sont les mêmes que celles du
gaz naturel : eau chaude sanitaire, chauffage, cuissons,
besoins industriels, etc. Une des valorisations pertinente
encore méconnue est la valorisation en carburant.
L’utilisation de biométhane en carburant dans les transports
(on parle de bioGNV) permettrait de réduire les émissions
de gaz à effet de serre dans ce secteur.
En outre, étant entendu que le bioGNV et le GNV (gaz naturel
pour véhicules) ont la même composition chimique, les véhicules
roulant au gaz ainsi que les stations de remplissage peuvent
être alimentés par du bioGNV sans modifications techniques.
 La composition des biogaz varie suivant
la nature des déchets soumis à la méthanisation
La composition des biogaz varie suivant
la nature des déchets soumis à la méthanisation
|
Composants
|
Ordures ménagères
|
Boues de station d’épuration
|
Déchets agricoles
|
Déchets de l’industrie
agro-alimentaire
|
|
CH4
% vol
|
50 - 60
|
60 - 75
|
60 - 75
|
68
|
|
CO2
% vol
|
38 - 34
|
33 - 19
|
33 - 19
|
26
|
|
N2
% vol
|
5 -0
|
1-0
|
1 - 0
|
-
|
|
O2
% vol
|
1 - 0
|
< 0,5
|
< 0,5
|
-
|
|
H2O % vol
|
6 (à 40 ° C)
|
6 (à 40 ° C)
|
6 (à 40 ° C)
|
6 (à 40 ° C)
|
|
H2S
mg/m3
|
100 - 900
|
1000 - 4000
|
3000 – 10
000
|
400
|
|
NH3 mg/m3
|
-
|
-
|
50 - 100
|
-
|
|
Siloxanes mg/m3
|
20 - 250
|
Traces
|
-
|
-
|
|
Organochlorés ou organofluorés mg/m3
|
100 - 800
|
-
|
-
|
-
|
Un
rapport INERIS (15/12/2009) mentionne des concentrations
d'oxysulfure de carbone (COS) de l'ordre de 0,047 à
0,29 mg/m3 dans le biogaz issu de la méthanisation
des boues de stations d'épuration.
Les
siloxanes
proviennent de produits tels que les shampoings déodorants
et sont donc présents dans les biogaz de station d‘épuration
et de décharges.
Ces substances peuvent causer de sérieux problèmes lorsqu’ils
sont brûlés dans des moteurs ou des appareils de combustions
(dépôt de silice).

Figure : Effet d'usure des siloxanes sur un moteur
.
 Le bilan des installations de méthanisation
et les perspectives
Le bilan des installations de méthanisation
et les perspectives
|
Le gisement de biogaz
en France
|
|
Nombre de sites actuels
|
Production actuelle (tep1/an)
|
Nombre de sites potentiels
|
Croissance potentielle (tep1/an)
|
|
Stations
d'épuration urbaines
|
150
|
65.000
|
200
|
150.000
|
|
Stations
d'épuration industrielles
|
64
|
64.000
|
400
|
800.000
|
|
Décharges
|
5
|
11.000
|
140
|
300.000
|
|
Méthanisation
des déchets solides (IAA...)
|
1
|
1.900
|
270
|
1.000.000
|
|
Digesteurs
agricoles
|
10
|
100
|
1.000
|
100.000
|
|
Total
|
230
|
150.000
|
2.000
|
3.250.000
|
|
1 tep = tonne équivalent pétrole
|
Voir
la carte des unités de méthanisation et de biogaz en France
 Le marché et perspectives du
biogaz en France (Source BaroElec) Chiffres
clés selon André Wipff
Le marché et perspectives du
biogaz en France (Source BaroElec) Chiffres
clés selon André Wipff
·
294,56
MW Puissance électrique installée fin septembre 2014
·
1
521 GWh Production électrique en 2013 soit plus 3
700 GWh par rapport à 2006
Objectif de production d’électricité à fin 2020 (soit
un total de 4 230 GWh)
· 1
640 emplois dans la filière à fin 2013
·
410
millions d’euros Chiffre d’affaires de la filière
en 2013
·
294,56
MW de puissance électrique raccordée fin 2014
Issu
de la fermentation de matières organiques animales ou végétales,
le biogaz est une énergie qui a beaucoup d’atouts.
Ses valorisations énergétiques sont multiples (chaleur,
électricité et carburant) et son caractère stockable permet
une utilisation en période de pointe de consommation.
Fin septembre 2014, la puissance électrique biogaz raccordée
au réseau ERDF en métropole et dans les DOM, répartie sur
312 sites, était de 294,56 MW, ce qui représente
une progression de 7 % par rapport aux chiffres de
septembre 2013.
La production électrique de la filière en 2013 s’est montée
à 1 521 GWh.
La contribution de la filière méthanisation au bilan énergétique
national est encore modeste (moins de 2 % des énergies
renouvelables consommées dans le pays), mais les pistes
de développement du biométhane (biogaz épuré et injecté
dans le réseau gazier) et du biogaz carburant donnent de
nouvelles perspectives.
Selon l’Ademe, la filière pourrait assurer plus de 14
% de la consommation française de gaz en 2030.
Dans son document “Contribution à l’élaboration de visions
énergétiques 2030-2050”, l’agence évalue qu’avec 600 installations
de méthaniseurs par an (soit presque deux fois moins qu’en
Allemagne), le gisement accessible serait de 6 Mtep
primaires en 2030 (soit 20 % de la consommation de
gaz estimée pour cette période).
La
filière est soutenue par des tarifs d’injection réglementés
et garantis :
·
Pour
les installations de stockage de déchets non dangereux,
les tarifs d’achat du bioméhane injecté sont compris entre
4,5 et 9,5 cent.€/kWh selon la taille de l’installation.
·
Pour les autres unités de méthanisation, les tarifs d’achat
du biométhane injecté se composent d’un tarif de base compris
entre 6,4 et 9,5 c€/kWh selon la taille de l’installation,
auquel peut s’ajouter une prime calculée en fonction de
la nature des matières traitées par méthanisation (intrants)
utilisés.
Réservé
initialement au biogaz issu d’unités de méthanisation agricole,
le biométhane s’est ouvert aux stations d’épuration en juin
2014.
À l’avenir, l’injection de biogaz est appelée à devenir
l’un des vecteurs de la transition énergétique française.
Le “Groupe de travail injection” piloté par l’Ademe et GrDF
a en effet évalué le potentiel de biométhane entre 3 et
9 TWh à l’horizon 2020.
D’ici à 2030, les projections font état de 500 à 1 400 sites
d’injection (selon les scénarios bas et haut de la feuille
de route méthanisation de l’Ademe), ce qui représentera
16 % de l’alimentation du réseau national de gaz.
 Le biogaz en secteur agricole
Le biogaz en secteur agricole
La
méthanisation permet de valoriser tous les déchets
agricoles pour les transformer en biogaz.
Cependant,
par rapport aux voisins allemands, la France est à la traîne
sur la mise en place du procédé.
Alors que l'Allemagne compte 8 000 installations, la France
n'en comptabilise que 200. Le gouvernement se fixe comme
objectif d'en installer 1 500 dans les trois prochaines
années. L'intégration de la filière méthanisation dans l'activité
agricole offre d'importantes opportunités :
- Produire de l'énergie renouvelable à partir de déchets,
d'effluents d'élevage et de productions agricoles, permettant
ainsi leur valorisation énergétique, agronomique et
économique, tout en contribuant à l'autonomie énergétique
des exploitations agricoles;
- Substituer de la chaleur, des carburants et engrais
d'origine fossile, et réduire les coûts d'intrants pour
les exploitations agricoles;
- Améliorer le bilan gaz à effet de serre des exploitations,
directement par la réduction des émissions de méthane
liées aux effluents d'élevage, et indirectement par
la substitution de chaleur, de carburants et d'engrais
d'origine fossile;
- Créer des opportunités pour améliorer les cycles de
rotation des cultures;
- Ancrer davantage les exploitations agricoles dans
la dynamique de leur territoire en apportant un revenu
complémentaire à leur activité principale.
Un projet de méthanisation peut être un élément structurant
au cœur d'un projet de développement durable d'un territoire
rural et permettre une diversification de long terme
des exploitations agricoles.
C’est
l'environnement agricole qui offre les plus grandes perspectives
de développement du biogaz en France.
On distingue deux catégories :
- les méthaniseurs à la ferme qui sont gérés par un agriculteur ou un éleveur,
- les unités territoriales qui gèrent les déchets de plusieurs sites agricoles
et/ou industriels.
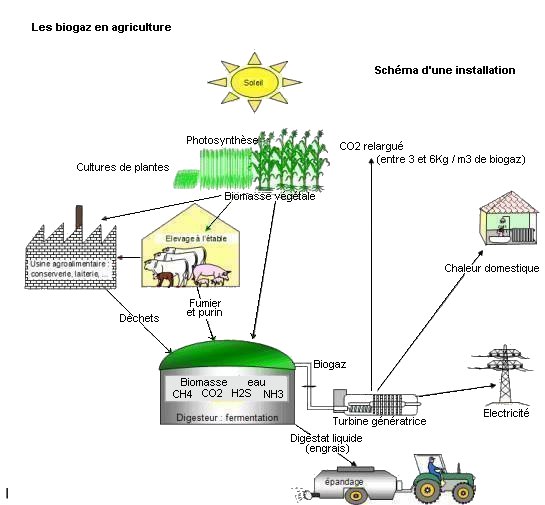
Schéma de production agricole du biogaz
Le potentiel de production d'énergie renouvelable
par cette technologie est en outre considérable, du fait
de son aptitude à valoriser une grande diversité de matières
organiques (déchets et productions agricoles, déchets des
industries agroalimentaires et des collectivités).
Le potentiel de développement de la méthanisation est variable
selon les territoires, en fonction de la disponibilité des
ressources méthanisables, des dynamiques et opportunités
locales.
Aussi, son développement en tant que complément de l’activité
agricole mérite d'être davantage soutenu dans une approche
ancrée dans les besoins des territoires et dans le respect
de leur diversité.
Fin 2013, on dénombrait 140 unités à la ferme en fonctionnement avec
une valeur cumulée du parc de plus de 24 MWe.
Pour 2014, le développement semble linéaire, avec une estimation
de 200 unités en fonctionnement à la fin de l’année.
En deux ans, le nombre d’unités opérationnelles est passé
de 90 à 200, soit une moyenne de 55 nouvelles unités par
an. La puissance moyenne des installations est de 180 kWe,
et tend à atteindre les 210 kWe.
La deuxième catégorie du biogaz agricole concerne les installations
centralisées ou collectives, de puissance plus importante
(1,2 MWe en moyenne).
Elles sont le résultat d’une association entre différents
acteurs du territoire, et sont longues à sortir de terre,
entre 5 et 7 ans, et moins nombreuses.
Fin 2013, 18 unités étaient en fonctionnement, soit
quatre de plus qu’en 2012, pour une puissance installée
totale de près de 20 MWe.
Cependant,
le développement des différents gisements reste très disparâtre.
 Des perspectives de développement
différentes
Des perspectives de développement
différentes
La filière biogaz regroupe deux grandes catégories de technologies
de production :
-
La production de chaleur et d’électricité
Elle représente la majorité des unités : stations
d’épuration, déchets de l’industrie agroalimentaire,
exploitations agricoles, ordures ménagères.
Il s’agit d’un digesteur anaérobie : une cuve fermée
et l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz
naturel, un autre vecteur de la transition énergétique.
-
Une solution de substitution à la production de chaleur
et d’électricité à partir de biogaz existe : le
biométhane.
L’injection de biogaz dans le réseau de distribution
GrDF apparaît de plus en plus comme une solution efficace.
Sur le plan des procédés, il suffit d’épurer le biogaz
initialement produit pour le débarrasser de composants
indésirables tels que le dioxyde de carbone (CO2), l’hydrogène
sulfuré (H2S) ou l’eau pour qu’il devienne totalement
opérationnel.
Sa teneur en méthane est alors plus élevée pour atteindre
une qualité similaire à celle du gaz naturel afin d’assurer
les mêmes usages :
cuisson, chauffage, production d’électricité ou carburant
pour véhicules.
Il existe actuellement en France cinq sites d’injection
en activité.
Retour
|
![]() Valorisation
Valorisation